Cet atelier organisé du 24 au 28 mars à Dar Bach Hamba en partenariat avec l’Art Rue et avec le soutien du Arab Fund for Art and Culture – AFAC – était destiné à des adolescent/e/s qui assistent à nos séances régulières de projections-débats. Il fait partie du projet “Images en partage 2024” et plus précisément du volet “Education à l’image” et il a été animé par Hajer Bouden et Insaf Machta.
C’est la troisième année consécutive que nous organisons cet atelier destiné au même groupe de participant/e/s et qui vise à renforcer leurs aptitudes à l’analyse de l’image et à les amener à exprimer leurs points de vue par le biais de l’écriture. Nous avons cherché aussi à les sensibiliser à la nécessité de passer de l’expression impressionniste à l’écriture argumentée et fondée sur l’analyse de l’image et de la mise en scène. L’écriture, et notamment le passage de la réception de l’image à l’expression de ses significations dans des textes écrits, nous semble primordial à une époque où l’image, avec ses supports multiples, a envahi la vie quotidienne.
Nous sommes parti/e/s de films programmés lors des 4 derniers mois dans deux cycles : la justice au cinéma et l’adolescence au cinéma. Le choix des films s’est fait de manière participative juste avant l’atelier et s’est porté sur : Nation estate de Larissa Sansour (Palestine), Will my parents come to see me? de Mo Harawe (Somalie), Mascarades de Lyès Salem (Algérie) et Adolescentes de Sébastien Lifshitz (France).
Nous avons revu les films pendant l’atelier, nous en avons longuement discuté et nous avons analysé une séquence de chaque film. Nous avons expliqué aux participant/e/s que les discussions et les analyses de séquences étaient censées les amener à formuler une idée susceptible de donner lieu à un article. C’était l’exercice proposé aux plus âgées qui avaient déjà écrit des articles lors des ateliers de critique de 2022 et 2023. Quant aux plus jeunes, nous leur avons demandé de rédiger un résumé d’un film de leur choix comportant des renvois à des situations précises. Nous avons également insisté sur la liberté de choisir la langue : le dialectal tunisien, l’arabe littéraire ou le français. Les 4ème et 5ème jours étaient entièrement consacrés à l’écriture selon une alternance entre la réflexion et l’écriture individuelles et les discussions autour des textes en cours d’écriture. A l’issue de l’atelier, il y a eu 2 résumés de films et 3 articles (deux écrits en dialectal tunisien et un écrit en arabe littéraire.
Articles traduits en français par Hajer Bouden
La peine capitale dans le film Mes parents vont-ils venir me voir ? : de l’absurdité d’une procédure à l’affirmation d’un refus
Par Souad Rebaï
Mes parents vont-ils venir me voir ? est un film somalien de Mo Harawé sorti en 2022. Le réalisateur y filme les dernières heures de la vie d’un jeune condamné à mort. Le film s’ouvre sur un personnage non moins important que le jeune homme : la gardienne qu’on voit, dès le premier plan, dans une voiture devant la prison.
Dans la séquence suivante, on voit une main qui dessine sur le sol avec de la craie. Cela nous fait penser à cette habitude des prisonniers de tracer des lignes pour calculer le temps qui reste. On découvre le visage du prisonnier dans le plan suivant, la caméra placée à son niveau. Commence le dialogue entre lui et la gardienne qu’on avait vue dans le premier plan, cette fois-ci filmée du point de vue de Farah, le jeune condamné à mort. On comprend de la question qu’elle lui adresse – « Que veux-tu manger aujourd’hui ? », question qui suscite l’étonnement au début – que la situation de Farah est différente de celle des autres détenus et que cette question fait partie d’une procédure qui précède l’exécution de la peine capitale. La réponse de Farah semble presque banale mais on comprend que ce repas est exceptionnel.
La deuxième formalité consiste en un examen médical qui paraît absurde : pourquoi s’assurer de la santé du prisonnier avant son exécution ? Le silence qui pèse sur la plupart des plans de cette séquence et les regards de l’équipe médicale qui expriment une sorte de compassion envers Farah nous font ressentir la gravité de la situation.
La formalité suivante, celle de l’entretien avec le fonctionnaire de l’administration pénitentiaire, nous permet de comprendre la situation du prisonnier avec plus de précision, car il s’avère que Farah est accusé dans une affaire liée au terrorisme. Le rôle du fonctionnaire est de s’assurer que le condamné à mort a compris la procédure. Le jeune homme n’a pas eu d’autre réaction à part cette question qui donne au film son titre : « Mes parents vont-ils venir me voir ? ». Ici se manifeste le véritable désir du personnage.
La séquence du repas, dont on peut dire qu’il fait partie de la procédure du fait qu’il s’agit de ce repas exceptionnel à dimension absurde, est nimbée de la même gravité que pendant l’examen médical, et ce, à travers les regards du cantinier qui sert les repas, la fixité de la caméra et la longueur de la séquence. L’apparition du personnage de l’imam et son entretien avec le condamné font partie de la procédure. Et malgré les tentatives de l’imam de communiquer avec Farah rien ne nous donne la possibilité de comprendre ce qui se passe dans l’esprit du jeune homme.
Parmi les moments les plus importants du film, l’attente des parents, séquence muette et lente qui nous met dans la même attente que le personnage, filmé à une relative distance. Cette distance permet de voir ce qu’il y a derrière lui : la gardienne qui l’accompagne dans son attente sans que l’un ou l’autre ne dise mot. On comprend la déception de Farah à sa manière de quitter les lieux en silence, lentement, sans manifester le moindre désir d’exprimer un sentiment quelconque. Mais le spectateur éprouve le poids de l’attente et la désespérance de Farah.
À la fin du film, on accompagne Farah vers un lieu désert où va avoir lieu son exécution. La dernière séquence est à mon avis la partie la plus importante du film. Le comportement du personnage change, lui qui était calme, impassible, sans réaction notable. Ici, Farah s’effondre, agrippe avec force le vêtement de la gardienne puis celui de l’imam comme s’il se protégeait derrière ces deux personnages en lesquels il a vu l’image de ses deux parents absents pendant les dernières heures de sa vie. La caméra accompagne l’effondrement du personnage sur le sol et la bande son ne nous laisse pas la possibilité d’entendre les cris de Farah dont nous parviennent quelques bribes noyées et inintelligibles, le bruit du vent dominant la séquence. La place de la caméra et le point de vue expriment le refus de rapetisser ou de rabaisser le personnage ; cela nous renvoie au contraire à la compassion du narrateur envers Farah et à son souci de préserver sa dignité. L’absence des cris de Farah souligne le respect de la dignité du personnage quand celui-ci faiblit pour la première fois dans le film, et il y a en cela un refus d’une dramatisation qui toucherait le spectateur de façon superficielle. Les moyens employés dans cette séquence permettent de penser et de ressentir ce qui se passe sans passer par un sentiment de pitié surplombant le personnage.
L’importance de cette séquence réside aussi dans les actes de la gardienne qui montrent un rejet de cette procédure. Elle est le seul personnage à refuser d’assister à l’exécution et au spectacle qui en résulte. On la voit dans la voiture, elle ne se retourne pas vers le lieu où s’applique le châtiment. Elle écoute la chanson qui nous a accompagnés dans plusieurs séquences, hausse le volume quand l’agent de l’administration pénitentiaire lui demande de couper la musique, puis quitte les lieux. La gardienne exprime à travers ces actes son refus de la peine de mort et nous sommes témoins de sa rébellion. Car le réalisateur a choisi de ne pas filmer l’instant précis de l’exécution ni la chute du jeune homme mais nous a fait accompagner la gardienne – personnage incarnant le refus – jusque chez elle. On s’arrête sur un plan qui exprime sa pensée profonde sur les événements et c’est sur elle que le film finit.

Le lieu dans le film Mes parents vont-ils venir me voir ? de Mo Harawe
Par Nourchène Dakoumi
Les lieux, dans les films, ont une grande importance. Le passage d’un lieu à l’autre peut exprimer le passage du personnage d’un état à l’autre ou dire quelque chose de son rapport aux autres personnages, et c’est ce qu’on observe dans le court métrage Mes parents vont-ils venir me voir ? du réalisateur somalien Mo Harawe, sorti en 2022. Il n’y a pas dans le film une grande diversité de lieux. La plupart des séquences sont filmées à l’intérieur de la prison, ce qui en soi raconte les chaînes imposées à Farah, le personnage principal.
Le film s’ouvre sur un espace extérieur : une voiture stationnée devant la prison avec, dedans, le personnage de la gardienne, ou plutôt l’accompagnatrice de Farah.
On se retrouve ensuite à l’intérieur de la prison, plus précisément dans la cellule où se trouve Farah. C’est la première fois qu’on le voit. Sa communication avec la gardienne est filmée avec la technique du champ contre-champ, mais pas d’une manière classique. La caméra filme la gardienne en contre-plongée, comme pour souligner l’autorité qu’elle incarne et, en même temps, le respect porté par le réalisateur au point de vue du jeune homme. Mais lorsque c’est lui qu’elle filme, la caméra se met à son niveau, pour ne pas le rabaisser. L’espace crée une sorte d’atmosphère de peur : la cellule est obscure, les couleurs sont sombres et les autres prisonniers, à l’arrière-plan, ressemblent à des fantômes.
La séquence suivante est filmée à travers des barreaux, on voit Farah avec deux gardiens et son accompagnatrice se dirigeant vers la porte extérieure du pénitencier. C’est la première fois qu’on voit la prison en étant derrière les barreaux. Les murs d’enceinte, vu depuis l’intérieur, révèlent des mesures de sécurité renforcées. Dans une autre partie de la prison, à travers les barreaux, on voit les membres d’une fanfare devant laquelle Farah passe. On comprend ici que quelqu’un observe et suit Farah des yeux depuis l’intérieur de la prison, probablement un des prisonniers qui va connaître le même destin.
Puis on accompagne Farah, pour la première fois dans le film, à l’extérieur de la prison. Il y a de la musique dans cette séquence. On voit Farah dans la voiture regardant par la fenêtre d’un regard étrange tandis que son accompagnatrice l’observe dans le rétroviseur. Les personnages arrivent à l’hôpital. Le visage impassible, Farah paraît absent. Il répond aux question de la médecin mais le reste du temps il demeure absent et sans le moindre lien avec le monde extérieur.
On retourne à la prison, mais dans un bureau et avec un nouveau personnage qui nous explique la situation de Farah. L’agent de l’administration pénitentiaire et le prisonnier sont face à face, filmés de profil, et d’un point de vue qui exprime la distance que le réalisateur prend vis-à-vis des méthodes administratives. On s’assure ici que toutes les procédures par lesquelles le personnage est en train de passer préparent son exécution et qu’il est accusé de terrorisme. Jusqu’ici on pouvait avoir des doutes mais à partir de cette séquence la situation devient claire car l’information principale est donnée par ce fonctionnaire. D’autres questions se forment alors dans l’esprit du spectateur : de quoi Farah est-il précisément accusé ? Serait-il innocent ?… Notre compassion naît à ce moment-là, non pas d’une manipulation du réalisateur au moyen d’effets à sensation mais de la multiplicité des hypothèses et des situations possiblement vécues par le prisonnier.
La caméra accompagne Farah à la cantine de la prison où on lui offre un repas meilleur que celui des autres prisonniers, ce qui fait partie de la procédure précédant l’exécution et consistant à réaliser les dernières volonté du condamné. Le comportement du personnage continue à indiquer, de l’extérieur, l’indifférence. Mais en même temps il indique peut-être sa force intérieure et sa capacité à affronter ce qu’il vit. Un nouveau personnage fait son entrée dans la cantine : à travers le comportement des prisonniers on comprend qu’il jouit du respect de tous. Il s’agit de l’aumônier de la prison, un personnage nouveau pour nous et pour le détenu. La caméra, fixe, filme le dialogue de profil, comme dans la séquence avec l’agent administratif. L’imam explique à Farah la procédure et l’informe de l’heure de son exécution, mais le prisonnier n’interagit pas avec lui et se contente de dire qu’il a compris. Une sorte de discours de consolation est offert à Farah de la part de tous les personnages, façon de faire croire que tout va se passer de manière ordinaire ou banale.
Dans une autre partie de la prison, on accompagne le personnage et la gardienne à la salle d’attente. C’est un moment important auquel le film doit son titre. Farah s’assoit sur un siège en bois, le regard immobile, fixé sur la porte, attendant sa mère et son père. Le lieu est nu et l’absence des parents représente un vide. Mais l’accompagnatrice, par sa présence, atténue l’impact de ce vide. La séquence se clôt par la sortie des protagonistes tandis que la caméra, fixe, reste dans le lieu. D’une manière générale dans le film, il y a une alternance entre des plans d’intérieur et d’extérieur, et une autre alternance entre le fait de filmer l’espace intérieur soit de l’intérieur soit de l’extérieur, à travers les barreaux ou pas. Filmer la cellule à travers la fenêtre raconte le sentiment d’exiguïté et l’enfermement. Et les images montrant les barreaux sont accompagnées d’une musique dont le rythme et l’énergie écartent tout appel à l’apitoiement.
Au déplacement d’un lieu à l’autre s’ajoute un déplacement d’ordre temporel et une alternance entre séquences diurnes (la plupart d’entre elles) et séquences nocturnes, précisément celles de la veille de l’exécution. Pour cette dernière nuit, le réalisateur crée, au moyen du montage, un parallèle et un lien entre le passage du temps tel que le vit Farah et tel que le vit la gardienne chez elle. La séquence est dominée par l’obscurité et les couleurs sombres. Dans l’un des plans filmés chez la gardienne, le champ est divisé en deux parties : une partie obscure qui occupe le tiers de l’image, comme si quelque chose voilait la caméra, tandis que le personnage occupe le reste de l’espace. Dans la séquence consacrée à Farah et qui se déroule dans le même temps, la caméra isole Farah des autres détenus et le rapproche, dans sa solitude, du personnage de la gardienne. Et malgré le faible éclairage on distingue, depuis des angles divers, son regard tendu vers l’inconnu.
La fin du film se compose de deux séquences construites sur une alternance temporelle entre la nuit et le jour et sur la relation entre Farah et la gardienne qu’on accompagne chez elle, la nuit, après la séquence de l’exécution qui avait eu lieu le jour et dans un espace désertique reculé. On la voit, dans un plan qui ressemble au plan nocturne de la veille de l’exécution, en train de réfléchir à ce qui s’est passé après qu’elle a refusé d’être le témoin des coups de feu et de la chute de Farah. Cette position de refus s’était construite sur plusieurs éléments : d’abord la musique qui s’était muée, de musique extérieure dans les autres séquences, en une musique jaillie de l’événement lui-même puisque c’est le personnage qui nous la donne à entendre depuis la voiture ; ensuite le cadre, qui avait créé une opposition entre l’exécution de la sentence et la réaction de la gardienne. Le plan supposé montrer l’exécution était filmé de loin à travers la fenêtre de la voiture, Farah au centre de l’image et la divisant en deux : une partie occupée par de nombreux personnages attendant le coup de feu et une partie occupée par la voiture de la gardienne, partie qui crée une opposition et un équilibre en mettant à l’avant-plan la position de refus. La force du plan réside dans le fait d’avoir confié à la composition spatiale une importance extrême et à l’espace du champ le soin d’exprimer des contradictions conduisant à affirmer une prise de position humaniste. Le dernier plan de la séquence de l’exécution, de manière plus générale, nous renvoie à la précision avec laquelle les lieux sont filmés dans tout le court métrage. Je disais au début qu’il n’y avait pas beaucoup de diversité de lieux dans le film, mais quand on se concentre on comprend qu’un seul lieu peut se ramifier en plusieurs recoins à travers lesquels se ramifie le sens.

Images et dimensions de l’adolescence
Par Asma Zarrouk
Adolescentes, le film du réalisateur français Sébastien Lifshitz , est sorti en 2019 et a été récompensé par de nombreux prix. C’est un documentaire qui suit le parcours de deux adolescentes, Emma et Anaïs, pendant cinq ans, de leurs 13 ans à leurs 18 ans. Le film est construit sur la différence de milieux dans lesquels les personnages ont grandi malgré leur amitié longue de plusieurs années. Emma appartient à une famille bourgeoise, contrairement à Anaïs qui a grandi dans un milieu populaire. Il y a des séquences ou on voit les deux ensemble et d’autres où on voit chacune d’entre elles avec sa famille. C’est cette alternance qui structure le film, créant une sorte de parallélisme et d’opposition entre les milieux sans réduire les personnages au côté social. Sur cette durée de cinq ans prennent place des séquences relatives à des événements politiques ayant secoué la France et auxquels on voit les personnages réagir.
Le personnage qui a le plus capté mon attention dans le film est celui d’Anaïs. Malgré son jeune âge et sa joie de vivre elle paraît, dans plusieurs situations, responsable. Ses rêves sont simples, ne sont pas difficiles à réaliser. Elle s’adapte à son milieu et choisit par exemple une filière professionnelle qui lui permet d’entrer rapidement dans la vie active et le monde des stages de terrain. On la voit travailler avec passion et aussi se poser des questions, par exemple sur son rapport aux enfants, pour décider plus tard de continuer plutôt avec les personnes âgées. Malgré la simplicité de son rapport au monde, il y a de la profondeur dans les relations d’Anaïs aux autres et dans ses questionnements.
Dans sa famille Anaïs joue trois rôles : celui de la mère, de la sœur et de l’amie. Son sens des responsabilités se manifeste quand sa mère tombe malade et entre à l’hôpital : c’est Anaïs qui s’occupe de ses frères comme une mère, dans la continuité des stages qu’elle a faits, et cela montre sa capacité à donner et son sens des responsabilités. Une période après la sortie de sa mère de l’hôpital, elle décide de vivre seule. Cela indique qu’elle veut bâtir une nouvelle vie et faire son chemin toute seule. Son départ de la maison affecte beaucoup sa mère qui, dans sa tristesse, devient comme une petite fille quand elle lui dit de ne pas partir ; c’est comme si les rôles s’étaient inversés.
Dans une séquence à portée politique, on voit Anaïs, tendue, parler avec ses parents de l’attentat terroriste contre Charlie Hebdo, répondre au discours raciste de sa mère en prenant la défense des musulmans qui ne sont pour rien dans ce qui était arrivé. Mais ce qui produit un choc au milieu du film, c’est-à-dire quelques années après, c’est, dans la séquence de l’annonce des résultats de l’élection présidentielle de 2017, quand on voit qu’Anaïs a voté pour Marine Le Pen, c’est-à-dire pour l’extrême droite qui joue sur la peur de l’étranger, aux antipodes de la personnalité d’Anaïs qui est en réalité tendre, sensible et qui prône l’égalité et l’antiracisme. Mais on comprend aussi pendant cette annonce des résultats que son vote était l’expression d’un refus de Macron qui représente pour elle la classe bourgeoise.
Cette annonce des résultats de l’élection à la télévision est filmée de façon parallèle. Le réalisateur nous montre deux familles différentes, celle d’Emma aussi, le deuxième personnage principal, qui reçoit les résultats avec une forme d’indifférence malgré la victoire de Macron. Ce choix au niveau du montage montre la lutte de classes, la différence de niveaux de vie des deux familles et son lien avec la vie politique.
Mais malgré la différence entre les milieux, il y a une amitié forte entre Emma et Anaïs, une amitié dont on ne sait pas si elle va durer ou pas après le bac. La force du film réside dans le fait de filmer la relation entre deux adolescentes et ce qui oppose leurs familles et leurs vies sans que cette opposition n’occulte d’autres dimensions de leur existence.
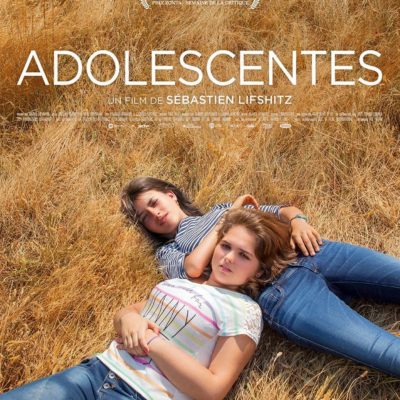
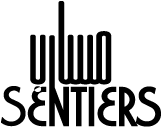


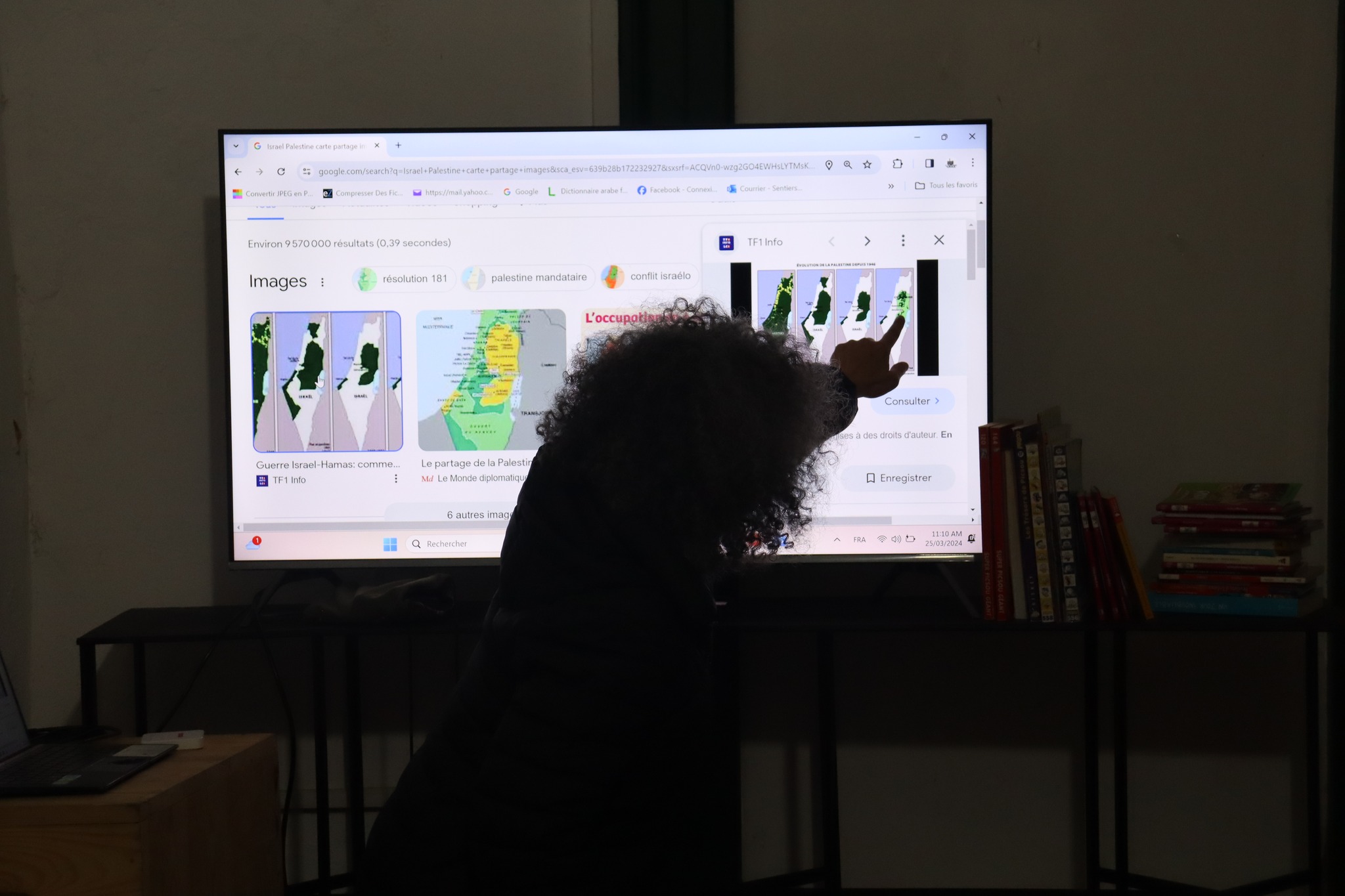





Laisser un commentaire