Cet atelier a eu lieu du 17 au 21 juillet à Dar Bach Hamba, il a été organisé en partenariat avec l’Art Rue et avec le soutien du CNC et de l’IFT. C’est le 2ème atelier dédié à la critique (le premier avait eu lieu l’année précédente), destiné au même groupe de participant/e/s. Il a été animé par Hajer Bouden et Insaf Machta, comme le précédent.
Nous travaillons tout au long de l’année avec les adolescent/e/s de Dar Bach Hamba sur l’expression orale des points de vue sur les films lors des projections-débats. L’initiation à la critique ou à l’écriture de textes sur les films fait pleinement partie de l’éducation à l’image. Il s’agit d’approfondir par l’exercice de l’écriture l’expression du point de vue, l’argumentation et l’analyse de l’image. Cela nous semble primordial à une époque où les jeunes sont sollicité/e/s par le déferlement des images et où il/elle/s manquent de recul face aux flux d’images consommées quotidiennement. L’écriture représente justement cette prise de distance nécessaire à la compréhension des images et à la construction du point de vue.
Parmi nos objectifs :
- Réfléchir collectivement sur les films programmés lors de l’atelier.
- Analyser des extraits de ces films.
- Formuler une problématique rendant compte des enjeux du film qui fera l’objet d’un article et la discuter avec les participant/e/s.
- Développer cette problématique sous forme de texte en se référant au film et/ou à certaines de ses séquences.
Les films sur lesquels nous avons travaillé ont été préalablement choisis par les participant/e/s parmi les films programmés l’année en cours et les années précédentes. Le choix des participant/e/s s’est porté sur les films suivants : Sherlock Junior de Buster Keaton, Nirin de Josua Hotz, F430 de Yassine Qnia, Sous les figues de Erij Sehiri et The Host de Bong Joon-ho. Si certain/e/s ont d’abord eu un peu de mal à s’adapter aux différentes étapes et à mettre en mots leurs ressentis et leurs émotions, d’autres, déjà initié/e/s à l’exercice pour l’avoir réalisé par le passé, ont rapidement ébauché des débuts de textes dans la langue de leur choix. Alternant entre réflexions individuelles et échanges collectifs, et avec l’appui des animatrices, trois participantes ont finalement pu proposer une version finale de leurs critiques. Nous avons décidé que pour les prochaines sessions de l’atelier de critique, nous continuerons à procéder de la même manière avec les plus âgé/e/s (qui ont pu finaliser leurs textes lors des ateliers de 2022 et 2023) mais que nous proposerons aux plus jeunes des exercices plus simples que la rédaction d’un article : description d’une séquence, rédaction d’un résumé personnel du film où on intègrerait ses impressions, etc.
On a eu trois critiques à l’issue de l’atelier ; deux ont été écrites en dialectal tunisien et une en français. Les articles en dialectal tunisien se trouvent sur la rubrique équivalente en langue arabe.
Articles traduits en français par Hajer Bouden
Le voyage de Nirin
Par Nourchène Dakkoumi
L’idée de voyage est d’habitude plutôt associée à quelque chose de positif et c’est ce à quoi s’attendait le personnage principal (un enfant d’à peu près 7 ou 8 ans) du film Nirin, court métrage de Josua Hotz sorti en 2015.
Le voyage de Nirin se fait en taxi collectif puis en voiture et on découvre trois lieux : la campagne, la ville et ses quartiers périphériques.
Le film commence dans la maison de Nirin. C’est une séquence sombre dans laquelle on voit Nirin et ses frères endormis pendant que leur mère parle au téléphone. La séquence se caractérise par une tranquillité qui émane de la nature qu’on aperçoit par la fenêtre. Nirin se réveille et sa mère lui apprend qu’ils vont partir en voyage, mais il ne sait pas que ce voyage a déjà commencé, en fait depuis la décision prise par la mère. Un peu plus tard on les accompagne dans ce voyage. Nirin est sûr de son retour au village, c’est ce qu’on comprend de ce qu’il raconte au lézard croisé sur leur chemin avant qu’ils ne prennent le taxi. Dans sa main, un jouet, une petite voiture en tôle tenue par une ficelle, qu’on verra tout le long du film et qui incarne les moyens de transport rencontrés, à commencer par le taxi collectif. Au début de la séquence du taxi, on vit des moments agréables ; Nirin fait des découvertes et les nomme : moto, voiture bleue, pont, lac. Le début du voyage est une ouverture sur un monde nouveau. Pour ce qui est de la façon de filmer, les plans extérieurs sont plus rares que les plans intérieurs. On voit la nature par la fenêtre mais la plupart du temps on reste coincés dans le véhicule, comme si on ne pouvait pas aller au-delà de la pauvreté et de la fragilité du réel. La sensation d’exiguïté augmente avec le temps et plus précisément dans la séquence nocturne quand les frères de Nirin se mettent à pleurer. Il y a ici comme l’anticipation d’un événement qui se produira à la fin du film. On voit des gens dérangés par les pleurs et d’autres, qui représentent le spectateur, en empathie avec les enfants. Pour la première fois, Nirin joue le rôle de la mère. Il essaie de calmer ses frères et y réussit contrairement à elle dont les capacités à consoler ses enfants paraît limitée.
C’est à nouveau le jour et le taxi de campagne s’arrête avec notre arrivée en ville. Le voyage continue dans un autre véhicule mais, avant, on s’égare dans un marché plein de monde avec Nirin qui ne retrouve plus sa mère. Cette séquence anticipe aussi la fin du film. Ce moment de perte est un voyage imaginaire et inquiet. Le spectateur ressent cette inquiétude sans la vivre avec le personnage, et ce sentiment découle de quelques choix : la caméra portée tenue au niveau du personnage et les séquences filmées à partir de son point de vue.
Nirin retrouve sa famille grâce à un nouveau personnage, l’oncle Émile, et le voyage se poursuit dans sa voiture. Entre les frères se tisse une relation basée sur la dualité retrouvaille / séparation. Dans la séquence suivante, on voit la mère, à l’extérieur de la voiture, en train de parler avec l’oncle Émile, d’un sujet mystérieux concernant ses enfants.
La voiture démarre, Nirin ne cesse de poser des questions sur leur destination, personne ne lui répond, mais sa façon de scruter la route nous montre qu’il essaie de trouver une réponse. La voiture s’arrête et on sent que l’instant est décisif. La mère sort de la voiture, elle est maintenant filmée à travers les vitres, ce qui crée une distance et un trouble malgré la transparence de l’obstacle. La caméra revient vers Nirin pour nous montrer l’impact que la sortie de sa mère a eu sur lui. Il la suit des yeux tout en bougeant. La caméra bouge avec lui, essaie de le garder toujours dans le cadre, l’isolant des autres personnages pour dire sa solitude et ses tentatives de communiquer avec sa mère qu’il appelle et qui ne lui répond pas. La caméra alterne entre la mère et Nirin. Pendant cette alternance on découvre la mère discutant avec une dame, une employée dans une maison d’accueil. Les regards de Nirin sont fixés sur elle dans une tentative d’élucider un mystère.

Les signes se multiplient qui indiquent l’imminence d’un événement douloureux, dont les pleurs des frères que cette fois-ci Nirin n’a pas pu consoler. Il a compris la décision de la mère lorsqu’elle est revenue et a pris ses deux frères. La tentative de Nirin de les retenir en s’agrippant à eux donne à la séquence une dimension tragique.
Le voyage continue encore mais on comprend, après la séparation entre Nirin et ses frères, qu’il va bientôt se terminer. L’arrêt de la voiture représente cette fois-ci quelque chose de définitif dans la vie du personnage : la mère l’abandonne dans le centre AÏNA. Le voyage finit là et Nirin s’arrête dans un premier temps au seuil du centre, la mère sort du champ sans lui parler, il part avec l’employée de la maison d’accueil sans marquer d’hésitation et sans se retourner vers sa mère, comme s’il avait accepté de faire un nouveau voyage. Dans le dernier plan du film, Nirin et l’employée du centre sont filmés de dos. Ils s’éloignent de la caméra et l’image se brouille comme si elle nous renvoyait vers l’inconnu mais en même temps comme pour nous montrer l’accompagnatrice sous un jour rassurant. L’éloignement de la caméra nous laisse aussi imaginer un autre voyage qui se déroulera loin de notre regard.
Un voyage intérieur
Par Asma Zarrouk
The Host, long métrage du réalisateur coréen Bong Joon-Ho sorti en 2006, raconte l’histoire d’un monstre qui a attaqué la ville, causant beaucoup de dégâts et tuant un grand nombre d’habitants. Il y a dans ce film une dimension parodique qui nous renvoie, dans une veine tragi-comique, à divers genres cinématographiques comme le film d’horreur et le film d’action. Son rythme est effréné, ses événements nombreux et il traite de sujets à la fois collectifs et individuels. Les personnages principaux sont les cinq membres d’une même famille sur trois générations : le grand-père, les fils et la petite-fille. J’ai choisi de me concentrer sur le personnage du père, personnage qui m’a paru drôle et singulier et qui a connu une grande transformation entre le début et la fin du film.
On voit le père pour la première fois dès la première séquence après le générique, en gros plan en train de dormir dans sa petite boutique. Il a un côté enfantin qu’on déduit de son rapport à sa fille quand il lui donne, avec une forme de désinvolture, une canette de bière pendant qu’ils regardent, insouciants et de bonne humeur, un match à la télévision. On comprend cela aussi des propos du grand-père : quand son fils était petit, il le laissait tout seul et c’est ce qui explique ses accès de sommeil. Le père a donc vécu une enfance solitaire et l’absence de la mère a eu une influence sur lui et sur sa fille. La première transformation que vit le personnage du père a lieu pendant sa lutte contre le monstre qui avait enlevé sa fille. De paresseux et glandeur il se mue en un combattant décidé à sauver la ville. On avait de lui l’image d’un être dissipé et sans crédibilité mais la perte de sa fille l’a réveillé de sa torpeur, a fait de lui un homme d’action et plus en phase avec son environnement. À la fin du film il parvient réellement à retrouver sa fille que le monstre avait avalée. Cette séquence nous fait penser à un accouchement. Les deux enfants qu’ils a sortis, sa fille et le petit garçon qui l’accompagnait, sont comme deux jumeaux, l’un vivant et l’autre morte, ce qui nous amène à la dernière transformation dans la dernière séquence du film dans laquelle on voit le père, à travers la même fenêtre, dans le même cadre du début, mais cette fois-ci bien éveillé, conscient du danger, armé et aux aguets. L’hiver a remplacé l’été, le petit orphelin occupe la place de sa petit fille perdue, et le père est devenu un père responsable. Ce sens des responsabilités, nouveau, qui s’est développé chez lui après l’expérience décisive qu’il a vécue, on le voit dans ses gestes quand il prépare la table, le repas, et dans la douceur du soin porté à l’enfant. Cette expérience lui a permis de s’accomplir en tant que père et l’enfant est ici comme une incarnation de lui-même, de sa propre enfance qu’il va préserver et reconstruire.
Ce film m’a beaucoup touchée parce qu’à travers des événements haletants et des scènes de lutte et de combats il raconte un voyage intime dans l’intériorité du personnage.

Article écrit en français
F 430 : le temps d’un rêve
Par Aïcha Antoine
F 430 est un court métrage de Yassine Qnia qui se déroule en banlieue parisienne, à Aubervilliers, où le réalisateur a grandi. Il raconte l’histoire de deux amis qui ont volé un sac qui semble être celui d’un vieil immigré, contenant ses papiers et sans doute toutes ses économies, en tout cas une très grosse somme. Ladhi, le personnage principal, décide de garder l’argent pour lui seul et prétend n’avoir trouvé que des papiers. Il utilise cet argent pour louer une Ferrari d’un rouge pétant avec laquelle il va frimer dans tout le quartier.
La dimension légèrement humoristique du film et de certains dialogues n’empêche pas la dimension absurde de la situation et même souligne une certaine gravité. Ladhi aurait pu changer complètement sa vie grâce à cette somme mais quelque part on le comprend quand même, il a tenté de réaliser un rêve d’enfant, nourri de fictions et d’actions, de films et de jeux vidéo. Il y est parvenu pour quelques rares moments, il a goûté au plaisir de s’exposer aux autres, bien que brièvement.

Le film aborde avec finesse plusieurs questions dont l’une des plus importantes concerne les rêves de luxe en rapport avec une réalité sociale difficile. Il est construit sur plusieurs contrastes qui soulignent cette opposition entre rêve et réalité : le luxe et la pauvreté du quartier, la couleur de la voiture et la grisaille des bâtiments, le grondement du moteur et le silence, la joie enfantine et la peur, la puissance du bolide et la panne qui fait redescendre le personnage sur terre.
Cette binarité n’empêche pas la complexité des situations et des personnages, bien au contraire, cette binarité n’est pas du manichéisme. Il y a des nuances d’énergies et de tonalités : le rire, la violence, la tendresse, le risque… Par exemple, les deux amis restent amis malgré leur bagarre. Cela peut paraître illogique au premier abord mais cette bagarre semble, paradoxalement, avoir renforcé leur amitié.
Ce n’est pas un énième film sur ce qu’on appelle la jeunesse des cités mais un film qui raconte une histoire à Aubervilliers. C’est un autre regard porté sur la banlieue et ses habitants, différent de ce qu’on cherche à nous donner à voir d’habitude dans les médias par exemple. C’est un film léger, subtil et dense, riche en émotions qui se côtoient et se superposent, sans que l’une d’elles domine ou impose un parti à prendre.
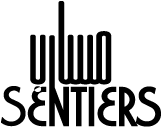








Laisser un commentaire